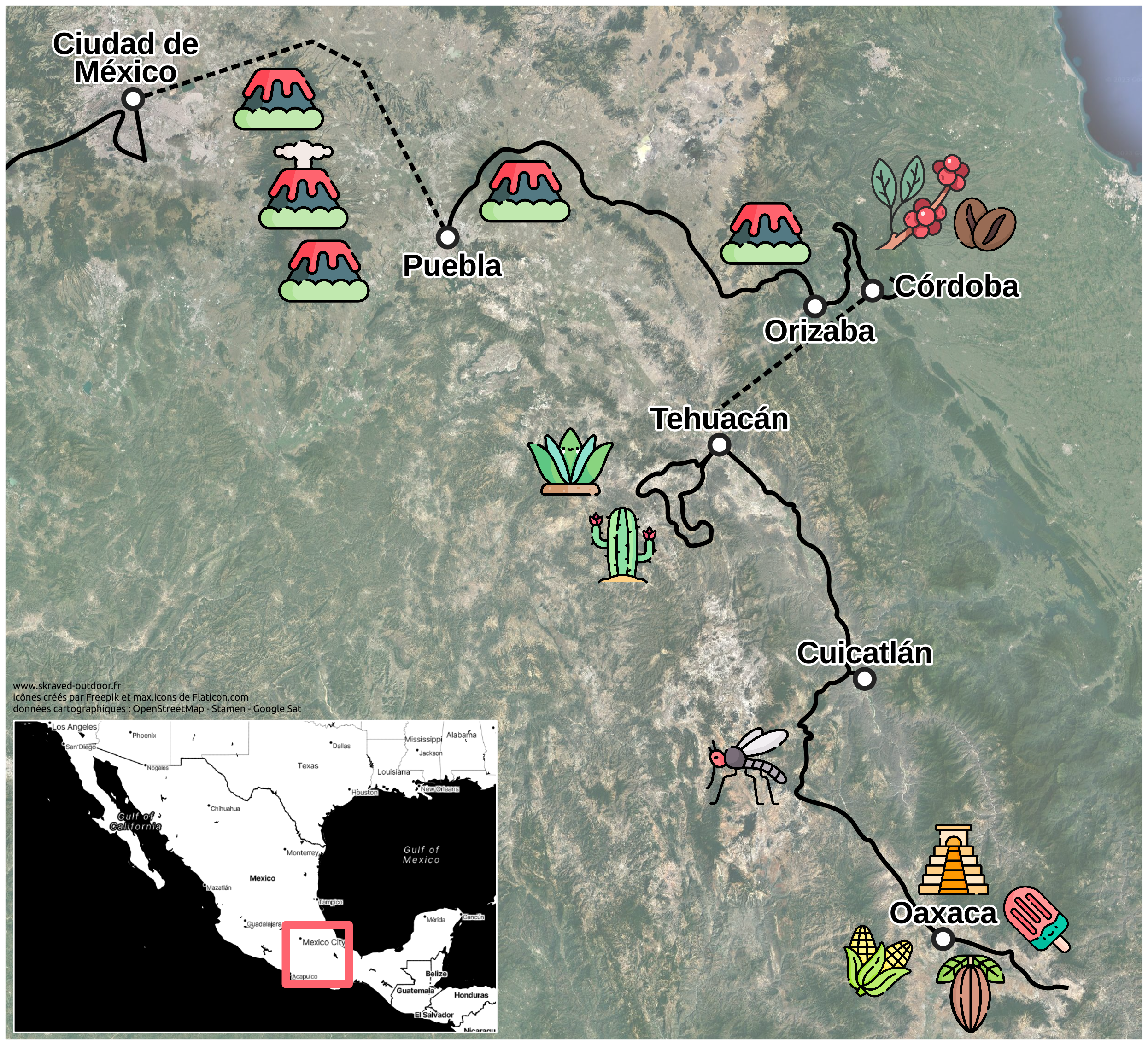Moins d’une semaine que nous sommes revenus au Mexique et il est déjà temps de partir. Pas parce que nous en avons fait le tour, loin de là. Nous reviendrons très certainement un jour revoir ce beau pays. Mais d’autres contrées nous appellent. Ou plutôt, la route nous appelle.
Cette dernière semaine, nous n’avons même pas fait de tourisme. Pas vraiment envie. l’État où nous nous trouvons (Quintana Roo) est le plus touristique du pays et même une des régions les plus visitées du monde. Nous ne sommes que des étrangers parmi tant d’autres. Ici trois types de visiteurs cohabitent : des plongeurs, des backpackers tendance neohippies et des familles et retraités à fort pouvoir d’achat. Étonnamment tous attirés par les mêmes endroits, par la nature incroyable, et incroyablement chèrement vendue : tout se paie, et le plus souvent au prix fort : camper, se baigner dans une rivière ou un cenote… Il paraît que les prix ont été multipliés parfois par dix ces dernières années et qu’une plongée ici coûte aussi cher qu’en Australie, l’un des pays les plus chers du monde. Seules les plages, propriétés fédérales, ne peuvent être privatisées au Mexique. Alors on y passe nos journées, en attendant de reprendre la route.
Bacalar, Tulum… Ces endroits sont magnifiques et pourtant nous n’avons pas un désir intense de les voir. N’avoir pas encore commencé à rouler ne nous donne pas envie de nous arrêter et profiter. L’appel du bitume est plus fort que celui de la plage. Mais je comprends tout à fait les gens qui viennent passer leurs vacances ici. Je ne serais pas surpris qu’un jour nous revenions, dans un autre état d’esprit et avec un autre budget.
À Bacalar nous avons rencontré un couple de français en van. C’est intéressant d’échanger avec des gens qui visitent les mêmes endroits que nous, mais d’une autre manière. Si voyager en van semble sur le papier plus confortable, c’est beaucoup plus contraignant que le vélo. Les passages de frontière sont plus compliqués, la sécurité aussi : alors que nous n’avons jamais eux le moindre ennui au Mexique, les motorisés se font apparemment fréquemment emmerder par des policiers corrompus. Et si un vélo peut facilement se mettre en sécurité dans une chambre d’hôtel, ce n’est pas le cas d’un véhicule motorisé. Le van au Canada, pourquoi pas, mais en Amérique centrale je préfère ma bicyclette.
Nous avons aussi rencontré deux autres voyageurs à vélo. Mark, la quarantaine, parti d’Allemagne en 2016. La location de son appartement finance son voyage. Pas de contrainte d’argent, donc pas de contrainte de temps non plus. Il avance à son rythme au gré des rencontres et des expériences. La belle vie.
Une deuxième cyclotouriste, avec qui nous parlons à peine 5 minutes mais qui nous déballe tout de sa vie, de sa vision du voyage à vélo ainsi que quelques conseils non sollicités sans s’intéresser le moins du monde à notre façon de voyager (« il faut ralentir, ne paie jamais pour rien, juste en énergie »). Elle entre clairement dans ma catégorie « hippie énervant » : ces gens qui croient être des exemples d’ouverture d’esprit et de compréhension mais ne s’intéressent pas aux autres et méprisent ceux qui ne pensent pas comme eux.
Bref, autant j’étais à l’aise partout ailleurs au Mexique, autant ici je ne me sens pas trop à ma place. Le Belize sera différent, pas forcément plus facile (probablement plutôt l’inverse), mais ce sera au moins une nouvelle expérience.